 |
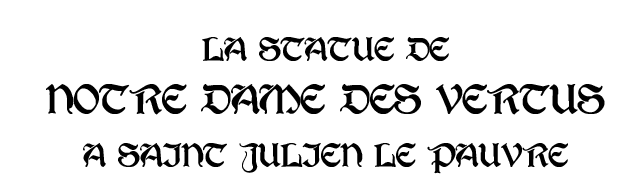
| Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'histoire religieuse de Paris au XVIIe siècle. A partir d'une recherche sur l'origine d'une statue de la Vierge, il a paru nécessaire d'élargir l'angle de vue autour d'elle en remontant jusqu'aux racines du pèlerinage à laquelle elle est liée, puis en redescendant avec lui le cours des siècles jusqu'à nous, et en ne se limitant pas à la confrérie dans son cadre étroitement parisien, car elle nous vient d'une époque où les rapports entre Paris et sa banlieue avaient peu de rapport avec ceux que nous connaissons maintenant. Ainsi, en essayant d'éclairer à travers elle la sensibilité religieuse d'une époque par les événements qui l'ont modelée, a-t-on rendu à l'Histoire un peu des couleurs de la vie . |
| Le texte que nous venons de lire est
l’introduction à la relation des miracles de Notre Dame
des Vertus, dans le « Théâtre des Antiquités
de Paris » , publié en 1612 par Jacques du Breul. On ne peut rêver de meilleur guide lorsqu’on veut faire la connaissance de cette Vierge, aussi discrète parmi les Parisiens d’aujourd‘hui qu’elle fut célèbre pour ceux d’autrefois. Jacques du Breul était moine bénédictin
à l’abbaye de Saint Germain des Prés, et avait
gardé jusque dans son quatrième âge une merveilleuse
curiosité d’esprit, servie par une non moins merveilleuse
agilité de plume. Il nous explique qu’un de ses amis lui a «
fait ce bien » de lui copier les textes accompagnant les tableaux
des miracles de Notre Dame des Vertus, en l’église
d’Aubervilliers. Il les a insérés intégralement
dans son ouvrage, d’où cette impression de témoignage
en direct qui nous le rend précieux. Peut-être a-t-il connu l’artiste qui a
sculpté la statue de Saint Julien le Pauvre. Elle a sans
doute été réalisée au moment de sa mort
(1614) ou peu de temps après. Mais, s’il avait pu la
voir, il l’aurait grandement appréciée. |
| Aubervilliers est mentionné pour
la première fois dans un acte de 1060, sous le nom d’
« Alberti - Villare » . C’était
donc à l’origine un domaine rural appartenant à
un nommé Albert ou Aubert. A l’époque du premier miracle, le « domaine d’Albert » était devenu un village prospère, dans la riche plaine maraîchère du Landy, à proximité de l’antique chemin processionnel de Paris à Saint Denis, et de celui qu’empruntaient les pèlerins du Nord de l’Europe pour se rendre à Saint Jacques de Compostelle. Il y avait là une chapelle dédiée
à Saint Christophe où les paysans venaient prier devant
une statue de la Vierge. Elle devint église paroissiale aux
alentours de 1300 , sous le double vocable de Saint Christophe et
de Saint Jacques le Majeur. Au cours des siècles, les miracles de Notre
Dame des Vertus ont été aussi nombreux que variés,
certains spectaculaires , d’autres plus discrets. |
Le miracle de la pluie La résurrection du fils du mercier. La résurrection d’un enfant mort-né |
| La période qui s’étend
du miracle de la pluie au 16e siècle est difficile à
connaître , par manque de documents à part le texte de
Jacques du Breul. Par contre, nous pouvons affirmer que le pèlerinage de Notre Dame des Vertus prit aux 16e et 17e siècles une importance considérable , en liaison avec des événements marquants de la Réforme et de la Réforme catholique. En 1529, sous François Ier, les fidèles
de toutes les paroisses de Paris vinrent en procession demander
son intercession. Leur nombre était si grand et l’éclat
de leurs cierges si intense que cette procession frappa les esprits.
Les habitants de Montlhéry crurent même que Paris brûlait. En 1628, Louis XIII promit solennellement à
Notre Dame des Vertus que, si son armée remportait la victoire
au siège de la Rochelle, il édifierait à Paris
une église dédiée à la Vierge. Mais les pèlerins les plus impressionnants
sont les grands réformateurs de l’Eglise de France,
en particuliers les fondateurs d’ordres. |
| Jacques du Breul nous dit
que les « Merciers du pays » se sont associés pour
fonder une confrérie sous le vocable de Notre Dame, par devoir
de mémoire et reconnaissance pour le miracle de la résurrection
du fils du mercier. Si l’on replace cette indication dans le
contexte, il semble que cette fondation se soit faite dans l’église
d’Aubervilliers , sans doute dès le 14e siècle. Néanmoins , une tradition veut que le père de l’enfant ressuscité ait fondé la confrérie des Merciers de Paris, dans le prieuré de Saint Julien. Le problème est que la grande confrérie des Merciers de Paris était trop prestigieuse pour qu’on ne soit pas bien renseigné à son sujet. Elle a été fondée au 14e siècle, mais apparemment pas sous le vocable de Notre Dame, et son siège n’était pas à Saint Julien le Pauvre. Cependant certains indices laisseraient penser que la confrérie de Notre Dame des Vertus s’est installée à Saint Julien sur un terrain préparé, peut-être par une branche annexe de la confrérie des Merciers, plus directement en rapport avec la tradition du miracle,et qui se serait ensuite fondue dans la confrérie de Notre Dame des Vertus, ou aurait déménagé. Au début du 17e siècle, la confrérie
de Notre Dame des Vertus apparaît officiellement à
Saint Julien, non comme une confrérie de métier regroupant
les membres d’une corporation, mais comme une confrérie
de dévotion « où toutes personnes sont reçues
». Le texte original de la bulle du pape Paul V qui l’institua
sous cette forme a été conservé ( 1606 –
1617 ). |
| Au début de l’année
1873 , la statue de la Vierge à l’Enfant fut retrouvée
à Saint Julien le Pauvre, sans doute dans une dépendance
qu’on n’avait pas explorée depuis la Révolution.
En principe, on n’avait que l’embarras
du choix pour la rattacher à l’une des confréries
qui avaient leur siège à saint Julien. En réalité,
le choix n’était plausible qu’entre la confrérie
des Maîtres Maçons et Charpentiers , dite encore de
Saint Louis, Saint Blaise et Saint Joseph, et celle de Notre Dame
des Vertus. En effet, on peut l’interpréter comme
un parfait exemple de l’influence du nouveau mysticisme sur
l’art français du début du 17e siècle. Et sans doute était-elle également très proche de l’ancienne statue d’Aubervilliers, dans la mesure où l’on peut s’en faire une idée d’après les gravures qui nous la présentent parée comme une Vierge espagnole ou flamande, et aussi dissimulée sous ses robes somptueuses et ses manteaux de cour , qu’une icône sous son revêtement d’orfèvrerie. Toutes ces Vierges sont des variations sur le même thème, réalisées dans un climat de libre parenté d’inspiration , à l’intérieur de la famille spirituelle où s’est développé le culte de Notre Dame des Vertus. |
| En 1872, l’abbé Laurent Amodru
fut nommé curé de Notre Dame des Vertus, avec la mission
de faire revivre le pèlerinage. Aussitôt il se mit à
la recherche d’une statue de la Vierge digne de remplacer celle
qui avait été brûlée à la Révolution.
Il était l’un des hommes les mieux informés
sur le culte de Notre Dame des Vertus et de Notre Dame des Victoires,
et sur les confréries fondées dans leur sillage. Quand on lui présenta la statue, il fut frappé
par sa ressemblance avec le modèle idéal qu’il
s’était formé. Il en commanda une réplique à l’identique
à un sculpteur de Paris , Monsieur Raffet, la fit curieusement
peindre en blanc, réactualisa son autel en conciliant l’aménagement
ancien et le dais néogothique, l’entoura d’une
palpitation d’ailes d’angelots et d’anges adorateurs
pour honorer son titre de reine des Anges, et poussa la fidélité
au texte de Jacques du Breul jusqu’à faire inscrire
sur les phylactères des angelots les initiales du verset
du Grâce au zèle de l’abbé
Amodru, la Vierge de Saint Julien le Pauvre nous accueille aux deux
extrémités de la route de Paris à Aubervilliers.
|
| Aujourd’hui, dans son église
à allure de cathédrale, dans le châtoiement de
ses vitraux relatant les riches heures de son histoire, Notre Dame
des Vertus n’est pas prisonnière de son passé. En prise directe avec les difficultés de la banlieue, mais aussi avec ses promesses d’avenir, le sanctuaire des Vertus continue à être un lieu de foi vivante, grâce à la Fraternité missionnaire de prêtres qui a la charge des paroisses d’Aubervilliers et à l’équipe d’animation pastorale. A l’heure où l’antique « village d’Albert » s’est dilaté à l’échelle de la planète , au cœur de l’arc-en-ciel de ses paroissiens et des fidèles du diocèse de Saint Denis , Notre Dame des Vertus est devenue, véritablement, « Notre Dame du Monde ». D’une façon étonnamment convergente,
quoique par une voie différente, la statue de Notre Dame
des Vertus de Saint Julien le Pauvre nous apparaît , non seulement
comme un signe de force et d’espérance , mais aussi
comme un appel à une ouverture qui va bien au delà
du passage du rite latin au rite grec. |
Denise Homerin - Barberon |
Du Breul ( Dom Jacques ) . Le Théâtre des Antiquités de Paris. Paris. C.de la Tour. 1612 / 2e édition : Le Théâtre des Antiquités de Paris. par le R.P.F.Jacques du Breul, Parisien, religieux de Saint Germain des Prés. à Paris, par la Société des Imprimeurs. 1639.
Liens : http://www.people.ku.edu/~asnow/ http://www.people.ku.edu/~asnow/saisle.html
|
